vues

Dans cette « République unie et indivisible », les inégalités d’accès aux droits fondamentaux économiques, sociaux et culturels n’ont rien de théorique. Elles se vivent dans les corps, les esprits, les trajectoires brisées. Elles sont visibles dans les taux de malnutrition chronique, significativement plus élevés dans les régions septentrionales ; dans les écarts d’accès à l’eau potable, à l’électricité, à Internet, à l’éducation de qualité, à la formation professionnelle, ou encore aux soins spécialisés. Ce n’est pas une plainte, c’est un constat. Et c’est précisément de ce constat que je tire la conviction que le Cameroun ne pourra se projeter dans un avenir durable sans une inscription effective des droits de deuxième génération dans son projet républicain.
Le Cameroun est riche. Mais cette richesse ne bénéficie pas équitablement à ses enfants. Le dernier rapport sur la Situation Économique du Cameroun 2025 Quatrième édition, produit par la Banque mondiale indique que « malgré la croissance globale de la richesse totale, la richesse nationale par habitant a diminué de 11 % entre 1995 et 2020… le Cameroun a ainsi connu un déclin de la richesse par habitant. ». Plus loin, le rapport laisse entrevoir que « le Cameroun n’a enregistré qu’une hausse modeste (14%) de son capital humain par habitant par rapport à ses pairs structurels et aspirationnels tels que le Vietnam et le Bangladesh ont connu des hausses remarquables de 92 % et 72 % respectivement, ce qui souligne l’urgence pour le Cameroun de renforcer son capital humain ». Pour compléter le tableau, ledit rapport laisse entendre qu’entre 2021 et 2024, près d’un million de Camerounais, « soit 700 000 ont rejoint le seul de la pauvreté extrême, portant de 6,2 à 6,9 millions le nombre de Camerounais qui vivent dans l’extrême pauvreté (moins de 1290 FCFA/jour) ». Il faut entre autres relever que cette extrême pauvreté au Cameroun se concentre dans les régions septentrionales. L’on peut comprendre juste aisément pourquoi dans l’Extrême-Nord, des projets agro-industriels exploitent la terre sans toujours garantir un retour juste aux communautés. Des multinationales extraient, avec l’aval de l’État, des ressources stratégiques pendant que les populations riveraines peinent à trouver un emploi stable ou un centre de formation professionnelle fonctionnel. Où est le droit au développement ? Où est la solidarité nationale ? Où est l’équité ?
Car il s’agit bien ici de justice sociale, d’équité territoriale et d’émancipation collective. Le droit à l’éducation, le droit au travail décent, le droit à la sécurité sociale, le droit à la formation continue et à la participation à la vie culturelle constituent les piliers d’une République solidaire, véritablement unie qui ne laisse aucun territoire ni aucun citoyen au bord du chemin.
Les droits civils et politiques (les droits de première génération) ont tant bien que mal certes ouvert la voie à la citoyenneté formelle. Mais ils n’ont toujours pas pu garantir aux Camerounais la possibilité d’exercer une citoyenneté réelle. Aujourd’hui, c’est par les droits sociaux et économiques et sociaux dits droits de la deuxième génération que nous devons construire la citoyenneté réelle. Une citoyenneté capable de réparer les fractures sociales, territoriales et générationnelles.
Ces droits ne doivent plus être considérés comme des « droits à conquérir plus tard », ou comme des promesses à faible valeur contraignante. Ils sont la condition même de la construction d’un nouveau pacte républicain camerounais, plus juste, plus équilibré, plus cohérent. C’est en assurant l’égalité réelle d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi qui constituent les trois leviers majeurs de la citoyenneté économique que nous pourrons véritablement redonner espoir à une jeunesse trop souvent confrontée à la précarité, au désenchantement ou à l’exil forcé vers les grandes villes voire hors du pays.
Je plaide pour que, dans le cadre d’une réforme constitutionnelle, le Cameroun inscrive clairement les droits économiques, sociaux et culturels dans ses textes fondamentaux, ses priorités budgétaires et ses politiques publiques. Ces droits ne doivent plus être une clause de style. Ils doivent devenir des objectifs concrets, mesurables, adaptés aux réalités locales. Une République ne se mesure pas seulement à sa stabilité politique, mais aussi à sa capacité à garantir à chacun un accès digne à l’éducation, la formation et l’emploi; bref le droit d’aspirer à de meilleurs lendemains.
Bien plus, le renouvellement du pacte social camerounais passera inévitablement par cette reconnaissance explicite de la dignité économique de chaque citoyen; par l’acceptation que la solidarité nationale n’est pas une option, mais une exigence. Il y’a donc urgence. Une urgence d’un plaidoyer et d’actions que le Mouvement Solij s’engage résolument à porter avec toutes les forces sociales engagées pour l’avènement d’un meilleur Cameroun.
Je ne suis qu’un jeune parmi d’autres. Mais je crois que notre génération, ancrée dans la réalité des territoires, peut porter un nouveau souffle républicain, plus juste, plus solidaire, plus impactant. Nous ne voulons pas seulement des promesses. Tout en assumant nos devoirs, nous exigeons nos droits; des droits. Des droits effectifs!
Bienvenue ATCHINALE Coordonnateur national de Solidarité Jeunes (SOLIJ)
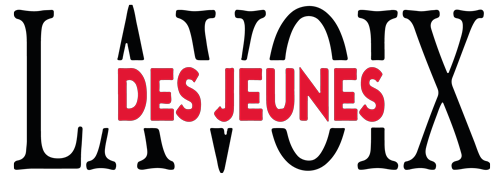
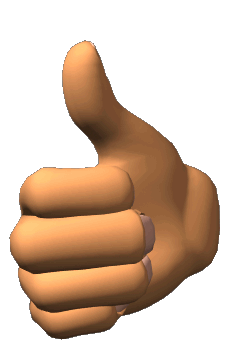
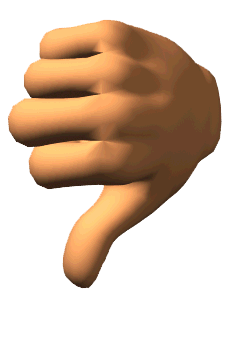










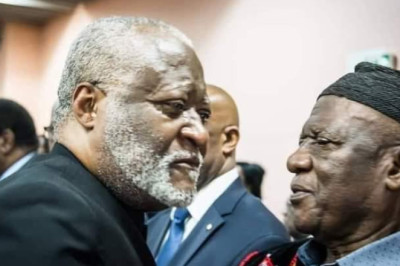
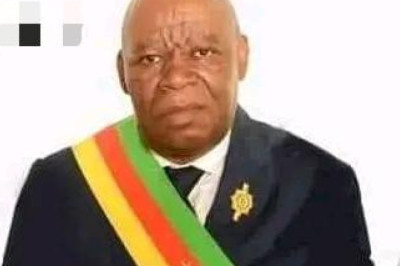
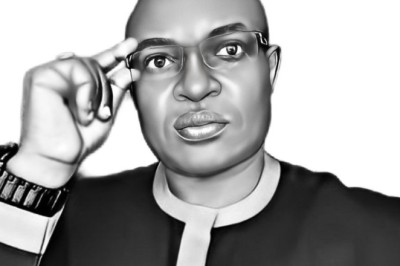




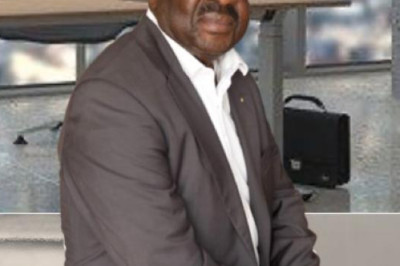

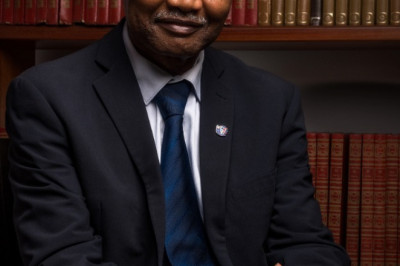
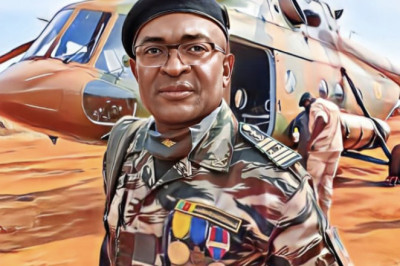










Ajouter un commentaire
0 commentaires